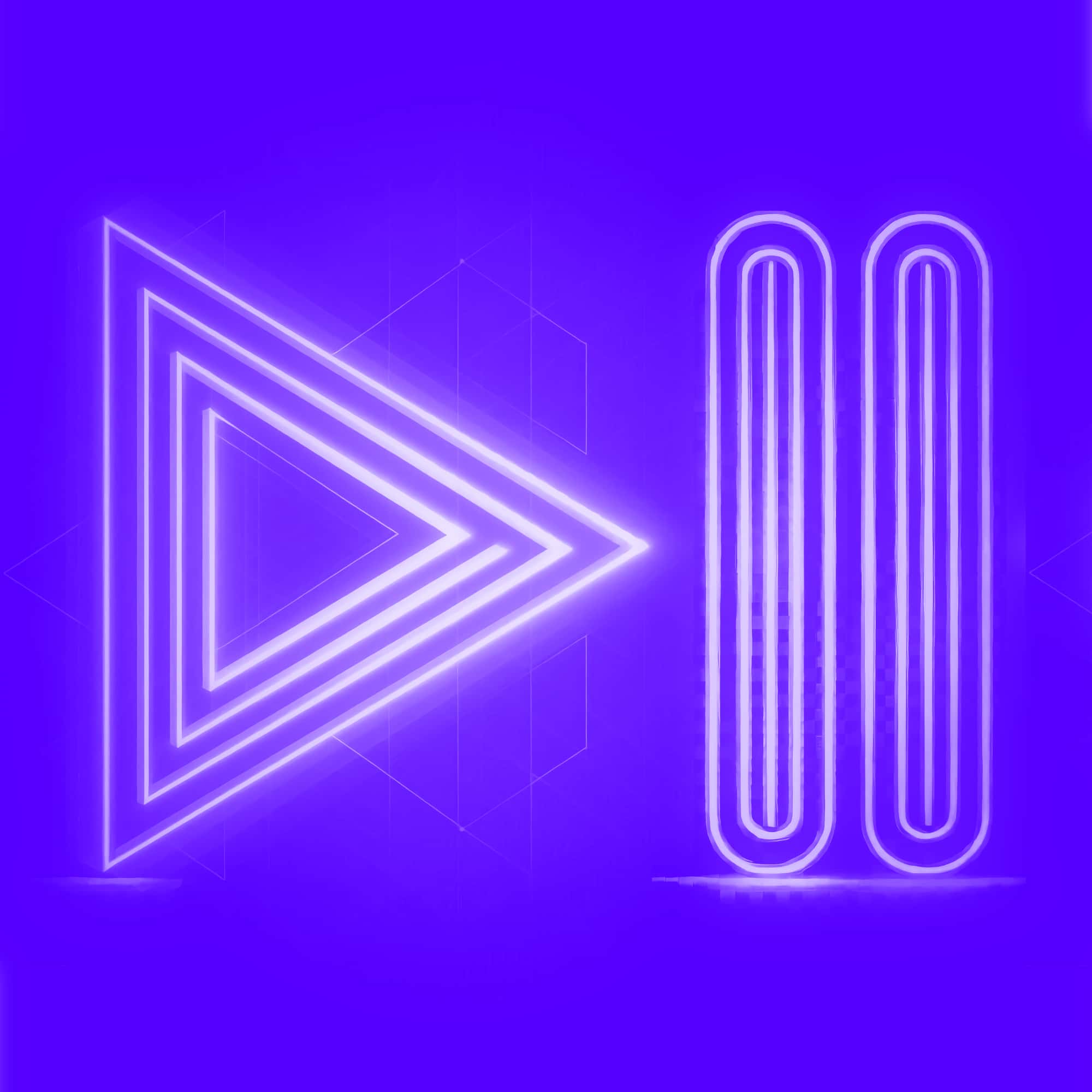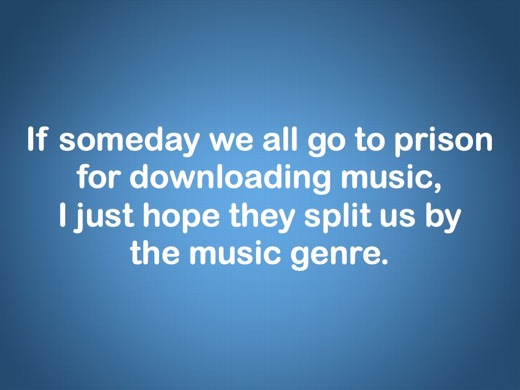
 2012 a bien commencé, enfin, pas pour tout le monde. Kim Dotcom (rien que pour ce pseudo ridicule, foutez-le en prison) pensait sans doute que ce serait l’année de son accession au titre de Steve Jobs 2.0, mais le FBI a préféré le crucifier avant même qu’il essaie. Enorme coup de communication de la part de cette institution qui aurait pu se contenter d’un mandat d’arrêt, d’une inculpation pour trois cents millions de motifs criminels et faits délictueux, mais non, il a fallu frapper encore plus fort, jeter le mec en tôle et saisir ses biens comme si c’était le boss d’un cartel colombien. Beaucoup l’ont dit et j’y souscris : Megaupload était indéfendable, même si tout le monde y a trempé sa souris un jour ou l’autre. Mais comme l’a fait remarquer @simoneduchemole : « Les américains, pour fermer Megaupload ils sont très forts, mais pour fermer Guantánamo il n’y a plus personne« .
2012 a bien commencé, enfin, pas pour tout le monde. Kim Dotcom (rien que pour ce pseudo ridicule, foutez-le en prison) pensait sans doute que ce serait l’année de son accession au titre de Steve Jobs 2.0, mais le FBI a préféré le crucifier avant même qu’il essaie. Enorme coup de communication de la part de cette institution qui aurait pu se contenter d’un mandat d’arrêt, d’une inculpation pour trois cents millions de motifs criminels et faits délictueux, mais non, il a fallu frapper encore plus fort, jeter le mec en tôle et saisir ses biens comme si c’était le boss d’un cartel colombien. Beaucoup l’ont dit et j’y souscris : Megaupload était indéfendable, même si tout le monde y a trempé sa souris un jour ou l’autre. Mais comme l’a fait remarquer @simoneduchemole : « Les américains, pour fermer Megaupload ils sont très forts, mais pour fermer Guantánamo il n’y a plus personne« .
Deux poids, deux mesures.
Quels intérêts si importants ont exigé le déploiement de tels moyens policiers autour du monde ? L’industrie de la musique, du cinéma, de la télévision, de la presse et de l’édition même (oui, oui, on peut même télécharger le pdf de « Internet pour les Nuls » illégalement) sont en crise, le raccourci facile est d’accuser le développement des cyberlockers que ni Hadopi ni l’IFPI n’ont le droit de surveiller ou de contrôler. Naguère, c’était les échanges de torrents et le peer-to-peer. Avant, c’était les graveurs de CD. Encore avant, les magnétoscopes, les magnétophones, les bootleggers qui reproduisaient des vinyles pirates, les faussaires qui contrefaisaient Van Gogh ou Monet. Si l’on remonte le cours de l’histoire de l’art, on trouvera toujours une bande de petits malins qui se sont affranchis des contraintes technologiques, légales, voire morales, au nom de la diffusion de contenus culturels, souvent intéressée. Sans parler des simples voleurs, qui n’ont besoin que d’un peu de doigté et d’audace pour acquérir sans frais le dernier Mylène Farmer ou « Tire-m’en deux, c’est pour offrir » de San Antonio.
Contenus ou produits ? C’est bien là le cœur de la question : contrairement au vin, au pain et au Boursin, les contenus n’ont de la valeur qu’aux yeux de ceux que ça intéresse. Les produits, en revanche, ont de la valeur pour ceux qui les produisent. On n’est pas prêt à mettre la même somme selon que l’on cherche une musique pour emballer les gonzesses ou que l’on gère les stocks pour faire monter les prix. La digitalisation devait mettre un terme à cette pénurie organisée, et on y était presque arrivé : Internet, notamment grâce à une myriade de blogs patiemment nourris et entretenus, était bel et bien devenu la banque mondiale de la création, une archive en expansion permanente où presque tout était accessible moyennant un abonnement à un FAI.
D’où l’indignation générale, bien légitime : ceux qui paient (parfois cher comme aux USA) pour avoir accès à ce cybermarché ne comprennent pas pourquoi il faut payer en plus pour consulter le contenu, voire le sauvegarder sur disque dur. Comme si on payait un droit d’entrée à la porte de Carrefour avant de passer à la caisse pour un baril de lessive : la double peine. D’où l’embarras des politiques qui ne savent pas comment légaliser ce transfert d’argent (avant on payait le disque, maintenant on paie la bande passante, autrement dit le droit de passage, au portier). D’où la panique dans les grands groupes audiovisuels qui n’ont pas compris (ou qui font semblant de ne pas avoir compris) qu’il est indécent de facturer (presque) aussi cher un fichier que le support physique (déjà une arnaque en soi, mais c’est une autre histoire) ou que l’expérience poétique d’une séance de cinéma. D’où l’hypocrisie des agences de pub qui se gavent sur la promotion de ces produits culturels mais aussi sur la concurrence entre fournisseurs d’accès et services en ligne. D’où la gêne de la presse spécialisée qui vit notamment des dites campagnes, alors que les journalistes téléchargent à tout va « à des fins documentaires ». D’où la fracture numérique entre la génération des digital natives et celle des consommateurs de bien matériels : le retour en arrière semble impossible, mais ce sont, pour l’instant, toujours les anciens qui dictent leur loi sur ce nouveau continent. Internet devait nous faire gagner du temps et de l’argent. En fait, ça nous prend tout notre temps et c’est un prétexte pour nous prendre aussi plus d’argent.
Kim Dotcom avait un autre plan en tête, qui menaçait de renverser le modèle vacillant. Pour peu que l’on se soit intéressé aux différentes formules d’abonnement à Megaupload ces derniers mois, le lancement de Megabox était imminent. Ce n’était pas un plan machiavélique et secret, simplement un énorme coup de pied sur le point d’être mis dans les couilles de la fourmillière (voir le clip de promo avec Kanye West et Kim Kardashian, un teaser WTF). Un raccourci entre créateurs et internautes faisant fi d’iTunes, de Spotify ou de tous ces abonnements premium qui (à mon avis) ne servent pas à grand chose (à part faire des profils d’utilisateurs, découper en tranches les modes de consommation et inciter à rester pas loin d’un écran qui affiche des bannières). Je ne dis pas non plus que cela aurait été la solution à tout, mais au moins une tentative de mettre en ordre les usages sans spolier ceux qui travaillent ou créent. Ajoutez une petite taxe sur les revenus générés par ce service, et tout le monde aurait pu y trouver son compte.
Mais la crainte de voir les positions dominantes des industries cuturelles remises en cause a été trop forte, et les agissements fort peu honorables de Kim Dotcom et ses potes auront été l’excuse toute trouvée pour les faire tomber, sous les ricanements des Anonymous les plus implacables. N’est pas Julian Assange qui veut. D’autres sites vont prospérer sur les cendres de MU, sans que cela ne fasse avancer le débat d’un pouce : pas plus tard que le week-end dernier, à l’occasion d’un anniversaire en famille, les bons plans s’échangeaient entre jeunes et moins jeunes, la grand-tante affirmant que « si je peux pas suivre la fin de la saison de The Good Wife, je sais pas ce que je vais devenir ».
Tandis que l’on voit s’étioler, du moins pour un temps, l’eldorado des contenus, quelles perspectives avons-nous ? La licence globale, une idée séduisante, est au fond inapplicable. Il faudrait déployer des moyens considérables de traçage des contenus, et résoudre tout un tas de questions philosophiques pour faire en sorte qu’elle soit moins invasive sur le plan de la vie privée qu’Hadopi et plus juste que la répartition SACEM. Les modèles émergents (streaming, abonnements, catch up, VOD…) ne règlent aucunement la question du piratage.
De la créativité et l’envie de rompre avec les schémas construits depuis un siècle sont nécessaires pour embrasser la dématérialisation des contenus « in a material world » : comme le chante China Moses, comme l’a chanté sa mère avant elle, can’t we break all the rules for a while?
 Probably PlayPause’s most extensive post, that develops my points of view regarding Megaupload and the Kim Dotcom case. But, long story short, here’s what I mean: music was never materialized to begin with. Prehistoric musicians never thought they could make a living out of their art, they probably never wanted to. Most post-cyber revolution artists won’t get rich either with their creation, but they’ll buy houses and pay for their childrens education with daytime jobs, endorsement deals and modelling contracts. Not that I find it exciting, life would be more fun and the world a better place if we could all just paint and dance all day long. Anyway, cultural industrialism has almost nothing to do with the primary purpose of artistic creation and performance.
Probably PlayPause’s most extensive post, that develops my points of view regarding Megaupload and the Kim Dotcom case. But, long story short, here’s what I mean: music was never materialized to begin with. Prehistoric musicians never thought they could make a living out of their art, they probably never wanted to. Most post-cyber revolution artists won’t get rich either with their creation, but they’ll buy houses and pay for their childrens education with daytime jobs, endorsement deals and modelling contracts. Not that I find it exciting, life would be more fun and the world a better place if we could all just paint and dance all day long. Anyway, cultural industrialism has almost nothing to do with the primary purpose of artistic creation and performance.
Enough said. I’d rather introduce China Moses‘s song, Bad For Me, from which the title of this post is taken. The track written in 1979 for her mother, Dee Dee Bridgewater, was originally a charleston/disco album opener made famous by the Larry Levan 12″ mix (available on YouTube, but absurdly muted). It was turned into a lush and infectious groove reminiscent of Diana Ross’s Love Hangover, in 1996. I love this version and had to search my CD collection to hear it again.
And it helps soften my very serious and radical statement: as long as soul singers can make uplifting tunes about bad romances, I’ll be fine with this industry’s greed.
Almost.

China feat. Dee Dee Bridgewater – Bad For Me
Si tu changes une lettre à Dotcom,
ça fait Dotcon.